ALFONS V EL MAGNÀNIM – EL CANCIONERO DE MONTESINO
Jordi Savall, Jordi Savall, La Capella Reial de Catalunya, La Capella Reial de Catalunya
21,99€
Reference: AV9816
- Jordi Savall
- La Capella Reial de Catalunya
Alphonse V a vingt ans quand en 1416, il monte sur le trône d’Aragon. Vingt ans et beaucoup d’illusions pour un règne en pleine crise économique, politique et sociale. Son propre père, Ferdinand de Antequera, n’avait reçu le royaume que quatre ans auparavant, à la mort du dernier descendant de la dynastie catalane, Martin l’Humain, et au milieu des conflits ardus de succession qui culminèrent avec le Compromis de Caspe.
Peu de mois suffirent pour apprécier les talents spécifiques de Ferdinand et de son fils Alphonse. Tous les deux mirent toutes leurs énergies à renforcer la présence catalano-aragonaise en Méditerranée et dès le début de leur règne et après de dispendieuses campagnes qui minèrent les fragiles ressources de la couronne, les Rois d’Aragon s’assurèrent un contrôle apparemment durable sur la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Cependant les désirs du jeune Alphonse V, rapidement connu comme “le Magnanime”, allaient très au-delà d’une simple présence favorisant les échanges commerciaux. Négligeant la faiblesse économique de ses domaines péninsulaires, il orienta ses plans vers la création d’un authentique “empire” méditerranéen, vers un règne qui devait donner à la couronne d’Aragon une présence nouvelle et inespérée dans le cadre politique européen.
C’est précisément cette attirance vers la Méditerranée qui poussa Alphonse vers une entreprise qui semblait éloignée de toute logique : la conquête de Naples. Après dix ans de campagne militaire, Alphonse V entra dans la ville le 6 Juin 1442 et montra dès le début qu’il n’avait aucune velléité d’un “colonisateur” mais celles d’un souverain résolu à convertir sa cour en un centre politique et culturel de niveau européen. Alphonse nomma Naples capitale de ses domaines, quand il prit conscience de la localisation stratégique de cette ville qui lui garantissait un contrôle parfait de la partie occidentale de la Méditerranée. Il se prépara donc à lui donner une grandeur et une projection internationale qu’elle n’avait jamais connues auparavant dans sa longue histoire.
Les principales initiatives du nouveau roi, maintenant dénommé Alphonse Ier de Naples, montrent l’importance fondamentale de la culture dans la mise en marche de son projet. Il fonda une importante Bibliothèque, il suscita la création de la célèbre Accademia Pontiniana et s’entoura de quelques uns des intellectuels les plus importants de son temps. Cette force culturelle devait lui survivre après l’arrivée sur le trône de son fils Ferdinand Ier, au talent plus pragmatique et plus versé dans des entreprises juridiques ou militaires.
La gloire de la cour catalano-aragonaise de Naples fut brève. Tant Alphonse que son fils ne surent ni comprendre ni résoudre les endémiques problèmes économiques d’une zone marquée par la pauvreté et les considérables déséquilibres sociaux. Dans les trois années qui suivirent la mort de Ferdinand, en 1494, divers monarques se succédèrent sur le trône de Naples, en une accélération d’événements qui résultèrent rapidement fatals aux intérêts de la dynastie. En 1502, après une série confuse de pactes et de trahisons entre le dernier Roi de Naples, Frédéric Ier, son fils Ferdinand, le Roi de France Louis XII et Ferdinand le Catholique d’Espagne lui-même, le conflit successoral aboutit à une guerre ouverte. Le 21 Décembre 1503, grâce à la bataille du Garigliano, les troupes espagnoles, sous les ordres du Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, assurèrent à la couronne d’Espagne un contrôle durable sur les territoires en question, contrôle qui devait se prolonger pendant plus de deux siècles.
Cependant, cette courte soixantaine d’années de domination aragonaise ne représente pas un fait épisodique mais un authentique événement culturel. Dans un sens strictement politique, le rêve d’Alphonse de constituer un “royaume méditerranéen” avait fini avant de commencer (au moment de sa mort “l’empire aragonais” fut divisé en deux entre son frère Jean II, qui héritait des domaines ibériques et Ferdinand Ier, déjà cité, qui ne jouissait que du titre de Roi de Naples), mais son utopie l’avait projeté vers un protagonisme dans une époque qui, particulièrement en Italie, voyait des transformations sociales et artistiques vécues comme une authentique “renaissance” culturelle.
Alphonse souhaitait marquer de son sceau personnel et unique cette étape inoubliable et extraordinaire de l’histoire de l’Europe et dans l’ensemble, il y a réussi. La cour de Naples, malgré sa proximité géographique de villes telles que Venise, Florence ou la Rome papale elle-même, a toujours présenté un caractère propre, reflet direct de sa personnalité et la musique a toujours joué un rôle fondamental, dans ce sens.
Depuis sa jeunesse Alphonse V avait encouragé la pratique musicale à sa cour. Chanteurs et organistes l’accompagnaient systématiquement dans ses nombreux déplacements, y compris lors de missions strictement militaires et sa Chapelle Royale en arriva à des dimensions tout à fait remarquables. Mais après la conquête de Naples, le nouveau cadre politique et géographique imposait de nouveaux défis à cette Chapelle qui, traditionnellement regroupait des chanteurs et des organistes originaires de diverses régions d’Europe. Au lieu de rechercher une homogénéité, Alphonse le Magnanime rechercha l’objectif opposé, suivant en cela les traces de son propre père : gascons, bourguignons, franco-flamands, allemands, castillans, catalans et italiens, d’origine très différentes, finirent par y cohabiter, convertissant la Chapelle en un reflet des idéaux politiques du monarque. La première conséquence en fut une pluralité linguistique complète, en accord parfait avec une cour dont le roi lui-même ne parla jamais bien la langue de ses sujets, dont, par ailleurs les dialectes ressemblaient peu à l’italien utilisé par les hommes de lettres. De fait, ce même Alphonse, – né à Medina del Campo, au cœur de la Castille – n’avait pas non plus été élevé dans la langue à tous effets “officielle” du royaume, c’est-à-dire la langue catalane qui s’utilisait pour les documents de chancellerie et de trésorerie. C’est ainsi qu’autour de lui, le catalan, le castillan, le français et l’italien dans leurs diverses variantes, se mélangèrent tout naturellement, sans compter, bien entendu, le latin.
La seconde conséquence, – complémentaire de la première – fut l’interprétation d’un répertoire musical étonnamment hétérogène. Chaque langue était liée à des rythmes, des formes, des genres poétiques et des recours rhétoriques profondément attachés à des traditions de chacune de ces régions d’Europe. Au lieu d’aplanir ces différences, la cour d’Alphonse le Magnanime semble les avoir amplifiées et la Chapelle Royale se transforma en un creuset d’expériences musicales diverses.
Il arrive souvent que le hasard nous offre des documents capables de se convertir en symboles de toute une étape de l’histoire de la culture. Le Cancionero de Montecassino, objet de cet enregistrement, est dans ce cas : un document historique fondamental qui est presque une métaphore de ce que fut l’utopie d’Alphonse le Magnanime. Toutes ses velléités, ses réussites et jusqu’au destin ultérieur de ses aspirations semblent se condenser en un manuscrit arrivé jusqu’à nous d’une façon qui frise le miraculeux.
Ce chansonnier est actuellement conservé dans les archives de l’Abbaye de Montecassino, située à mi-chemin entre Rome et Naples et maison mère de l’ordre bénédictin. Il se compose d’une centaine de feuilles qui occupent la partie conclusive d’un tome de 436 pages, d’une dimension moyenne (20,6 x 27,6 cm), et que la reliure relativement récente présente comme “Manuscrit N 871”. Un rapide coup d’œil suffit pour nous rendre compte des vicissitudes endurées par ce document, objet de mutilations et d’intégrations successives, et dont la longue histoire commence au monastère de Saint Michel Archange à Gaeta. Il est probable qu’un moine de ce centre l’ait rédigé et que c’est là qu’il était conservé jusqu’à son transfert à Montecassino. Le volume s’y trouvait à la fin du XVIIIème siècle où il survécut miraculeusement à un terrible bombardement qui anéantit l’Abbaye en février 1944. Mais cet historique accidenté ne suffit pas à expliquer l’impression d’hétérogénéité (y compris graphique) que laisse ce texte et qui en constitue précisément l’un des aspects distinctifs. Cette variété, soulignée par les divers types d’encre et de styles d’écriture, naît justement de son contenu et prend toute sa transcendance si l’on pense que le manuscrit est l’œuvre d’un seul et unique copiste.
Ce n’est pas un fait insolite qu’aux XVème et XVIème siècles, on ait réuni le répertoire des différentes chapelles musicales en “Cancioneros” composés d’œuvres de différents auteurs et parfois de styles très divers. Ces anthologies sont le reflet des activités multiples de ces ensembles qui, normalement devaient assurer tant les services religieux que les exigences privées des nobles dont ils dépendaient. Ce qui explique que dans ces volumes, les œuvres religieuses et les œuvres profanes cohabitent souvent dans une égale dignité. C’est bien le cas du Cancionero de Montecassino, qui contient 141 compositions – 64 religieuses et 77 profanes – mélangées sans aucun ordre apparent : une réunion du sacré et du terre à terre qui est en soi un premier élément de variété.
Mais au delà de ce premier niveau, d’autres se cachent non moins significatifs. Le plus remarquable reste, bien sûr la pluralité linguistique des œuvres profanes : le français, l’italien, le castillan, le catalan se répartissent ces textes poétiques, sans compter les variantes linguistiques, tels les catalanismes qui caractérisent certains textes castillans et le généreux emploi des différents dialectes italiens. Et, pour finir, la diversité stylistique. Le Cancionero de Montecassino comprend des œuvres composées entre 1430 et 1480, en une époque de transition particulièrement délicate dans l’histoire de la musique européenne. Des formes traditionnelles comme la chanson de cour étaient en train de se transformer lentement et de nombreuses formes populaires entraient peu à peu dans le répertoire culte. Ce manuscrit permet de suivre avec attention cette évolution, mais depuis une perspective qui, une fois de plus, ne recherche pas tant la “fusion” des genres que leur juxtaposition. Les chansons de cour extrêmement raffinées d’inspiration française côtoient d’innocentes mélodies populaires ; des danses campagnardes symétriques alternent avec des structures polyphoniques denses. Le transcripteur anonyme, tant s’il s’agit d’œuvres de compositeurs connus que de compositions de style populaire, semble rechercher, avec un sens particulier de la méthode cette spécifique cohabitation des styles.
Les œuvres appartenant à ce double album sont un parfait reflet de cette variété d’options. Même en ce qui concerne le répertoire religieux, le Cancionero de Montecassino offre un fascinant échantillon de ce que fut la pratique musicale vers la moitié du XVème siècle. Les œuvres sont principalement en relation avec les Offices des Heures, selon la pure tradition bénédictine. Quoique la plupart d’entre elles nous aient été transmises de façon anonyme, les noms propres ne manquent pas, en commençant par les principaux compositeurs au service de la cour napolitaine (Gaffurio, Oriola, Cornago) et en culminant avec les grands polyphonistes franco-flamands Ockeghem et Dufay. On doit, par exemple, à ce dernier un Magnificat à 4 voix d’un grand raffinement qui constitue un exemple idéal de la perfection atteinte vers 1460 dans le contrepoint nordique. Par ailleurs, les deux versions de l’hymne Ave Maris Stella qui le précèdent, montrent jusqu’où la dévotion à la Vierge pouvait emprunter des formes différentes entre elles : la première, à 3 voix, est très probablement un produit étranger à la cour napolitaine, tant elle est chargée de claires résonances médiévales, tandis que la seconde, à 4 voix, est l’œuvre d’un compositeur local, animé par la volonté de concilier une sensibilité clairement harmonique avec un subtil tissu polyphonique (œuvre présentée ici dans une version instrumentale, selon une pratique habituelle durant toute la Renaissance).
C’est un climat bien différent, proche de la dévotion populaire, qui se révèle dans l’écriture presque homophonique de l’antienne anonyme Adoramus te, réservée à la cérémonie de l’adoration de la Croix du Vendredi Saint et dans l’hymne Patres nostri peccaverunt de Johannes Cornago, certainement écrit à l’occasion des célébrations de la Semaine Sainte. Les cérémonies les plus significatives parmi celles, nombreuses, qu’organisait la cour de Naples (dans ce Castel Nuovo qu’Alphonse le Magnanime fit reconstruire dans les formes qui, à partir de là, devaient marquer de façon indélébile le profil de la ville) étaient liées à la Passion. Très probablement, c’est ce même type de manifestations qui donna naissance aux hymnes processionnels Cum autem venissem, en relation avec la cérémonie de la déposition, et Vexilla regis prodeunt, présenté dans le Cancionero de Montecassino précédé par une intéressante élaboration polyphonique de l’invocation Miserere nostri Domine. Dans les deux cas, le style d’accords et le choix de lignes mélodiques claires et symétriques répond à la volonté de ne pas s’éloigner d’un style populaire aux antipodes des complexités raffinées d’un Ockeghem ou d’un Dufay.
Cette diversité stylistique est encore davantage mise en évidence dans la musique profane. Pensons au cas des trois chansons ici présentes, trois exemples très différents pour traiter un genre prestigieux qui avait atteint des sommets de raffinement entre les XIVème et XVème siècles. L’une, De tous bien plaine, est une chanson courtoise “pure”, présentée ici en version instrumentale car ce manuscrit n’inclut pas les paroles. Puisque vos me lasses seulette, en revanche, est une chanson “double”, résultat de la superposition de deux poèmes différents, l’un traité polyphoniquement et réservé aux voix aiguës et l’autre, présenté de façon monodique et destiné aux voix graves. Cependant le cas le plus ingénieux est le troisième, une œuvre de Dufay : dans Je vos prie mon tres doulx ami les textes poétiques qui se superposent sont trois, chacun avec sa personnalité spécifique, dans un déploiement de raffinement de composition qui ne prétend à aucun moment éclipser le caractère éminemment populaire d’une partie du matériel mélodique employé.
La tendance à la simplicité prédomine dans la majorité des œuvres les moins directement concernées par le genre de la chanson, comme la brillante Fille Guillemin. Mais ceci n’empêche pas le copiste anonyme de ce Chansonnier de nous avoir également laissé des œuvres aussi élaborées et complexes que la chanson-motet funèbre Mort tu as navré, composée par Ockeghem à l’occasion de la mort du grand compositeur Gilles Binchois. La déclamation du texte poétique en français se superpose ici à une élaboration contrapuntique d’un autre texte latin Miserere Pie Jhesu, créant une dense polyphonie à 4 voix.
De même, les œuvres sur des textes italiens se caractérisent par une même diversité de formes. C’est ainsi que nous allons des subtilités raffinées de Piangendo chiamo jusqu’à l’atmosphère populaire de Correno multi cani, en passant par les asymétries pleines de gaîté de O tempo bono, et avec une propension envers un côté rural qui transparait dans les titres des pièces instrumentales elles-mêmes, comme dans l’inoubliable Zappay lo campo (dont la traduction littérale est “je labourai le champ”).
Le style presque improvisé de Merce te chiamo, les effets imitatifs raffinés de Chiave, chiave, le climat allègrement “goliardesque” de Alle stamenge sont les différents visages d’une phase fort peu documentée de l’histoire de la musique, pour laquelle le Cancionero de Montecassino représente une source d’une importance capitale. Parmi toutes ces formes brèves, ne négligeons pas la curieuse complexité de Amor tu non me gabasti avec son écriture imitative élaborée à 4 voix et ses élégants recours rhétoriques, tout ceci au service d’un texte particulièrement léger. Il s’agit d’une barzelletta (c’est à dire une “blague”) une forme poético-musicale très fréquente dans l’Italie du XVème siècle et qui acquiert ici le ton enjoué de celui qui enlève de sa transcendance à la tradition polyphonique “culte” elle-même.
Finalement, les pièces d’origine ibérique. Ce sont elles qui indubitablement réussissent à illustrer avec le plus de précision l’importance de ce document en tant que témoin historique et culturel. Parmi les compositions incluses dans cette sélection, la plus complexe est la chanson Qu’es mi vida preguntais de Cornago, une œuvre pour 3 voix à l’origine et qui est ici présentée dans la version qu’Ockeghem en réalisa (probablement durant son séjour en Espagne, en 1469), dans le respect de l’écriture originale et en se limitant à y ajouter une quatrième voix à la basse. L’humilité avec laquelle Ockeghem – sans doute le plus grand compositeur de son époque – approche l’œuvre de Cornago, alors fort apprécié à la cour catalano-aragonaise de Naples, produit un résultat qui intègre des éléments hispaniques et franco-flamands dans une œuvre d’une subtilité stylistique insolite.
D’un ton différent, les deux autres compositions sur des textes espagnols n’en sont pas moins significatifs. L’une, Viva viva Rey Ferrando, fut écrite pour célébrer la gloire de Ferdinand Ier, peut-être à l’occasion de son couronnement ou, plus probablement après sa victoire contre l’insurrection des barons en 1461. On y célèbre conjointement les succès militaires et amoureux du fils d’Alphonse le Magnanime, dans un climat festif et solennel. L’autre, Dindirindin, est écrite sur un texte marqué par l’onomatopée qui donne son titre à l’oeuvre, et constitue l’emblème maximal d’un répertoire qui semblait évoluer en Méditerranée, ignorant distances géographiques et barrières linguistiques. Cette pièce s’est conservée sous trois versions différentes, chronologiquement très proches les unes des autres : une à 3 voix, présente dans le Cancionero de Montecassino, une autre, à 4 voix, incluse dans le Cancionero de Palacio, et une troisième, monodique, conservée dans un manuscrit français de la fin du XVème siècle. Dans les trois cas, le texte mélange avec un parfait naturel des langues différentes, avec pour axe unificateur la présence constante de la langue catalano-provençale.
Il s’agit, sans aucun doute, d’une digne conclusion pour une anthologie qui nous transporte pendant plus de deux heures vers cette “renaissance” qu’Alphonse le Magnanime voulut construire à partir de sa cour napolitaine. Une conclusion qui nous rappelle les immenses différences qui séparent ces projets utopiques de cette autre Renaissance qui, dans le même temps, surgissait au sein des cours voisines romaine et florentine. La Florence de Laurent le Magnifique poursuivait l’idéal de la perfection esthétique et l’élévation intellectuelle, considérant l’exemple de l’Antiquité gréco-latine ; La Naples d’Alphonse et de Ferdinand trouva ses marques d’identité dans la juxtaposition d’apports géographiques et culturels différents. La Péninsule Ibérique avait toujours été un croisement de cultures et il est donc parfaitement logique que les Rois catalano-aragonais, au moment d’entrer en contact avec une Italie au passé historique si différent, aient cherché à réaffirmer ce qui avait depuis toujours été le caractère distinctif de leur culture.
En ce sens, le legs de la cour catalano-aragonaise de Naples finit par être rapidement absorbé (tant dans le domaine culturel que politique) par d’autres pouvoirs. Cependant, un petit détail, qui devient au long de tout le Cancionero de Montecassino d’une grande évidence, nous permet de supposer qu’un élément est resté constant, probablement alimenté grâce précisément au contact des deux cultures. Il s’agit d’un phénomène de peu d’importance apparente mais susceptible de marquer d’un signe distinctif la sensibilité qui a permis la création d’un répertoire tellement hétérogène : la présence constante de la “cadence à la tierce inférieure”, c’est-à-dire cette phrase mélodique particulière qui était habituellement utilisée durant la première moitié du XVème siècle, pour conclure les vers avec une tournure du type Do-Si-Si-La-Do. Depuis le recueillement de l’Adoramus te initial jusqu’aux brillantes versions, y compris celles d’Amor tu non me gabasti et Viva viva Rey Ferrando, cette cadence particulière se retrouve tout au long de cet enregistrement, ignorant toute distinction stylistique ou linguistique.
Le lien qui perdurait, autour de 1480, avec cette formule si traditionnelle ne supposait pas seulement une attention constante à la tradition franco-flamande et au répertoire d’hommes tels que Dufay. Il signifiait aussi autre chose : la volonté de résoudre les problèmes de composition en clé strictement mélodique, en cherchant – y compris dans les pièces les plus élaborées – des solutions formelles étrangères à ce qui plus tard a été qualifié de “sensibilité harmonique”. Et il est impossible de ne pas y reconnaître l’influence de cette tradition monodique dans laquelle napolitains et catalans se distinguèrent traditionnellement, au point de convertir leurs chansons populaires respectives en trésors parmi les plus appréciés des deux cultures. Le goût pour l’expression mélodique et pour l’anonyme expression d’un sentiment collectif a pu être un point de ralliement capable de franchir les barrières sociales, géographiques et culturelles et le Cancionero de Montecassino, dans bien des sens, le prouve ainsi.
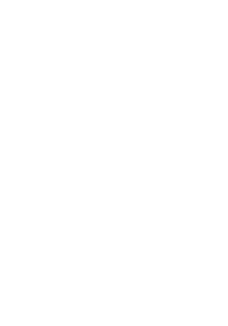
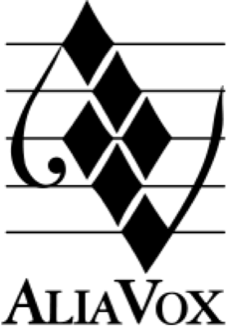





Partager